|
EXTRAIT DU LIVRE “RAMA VIVE”
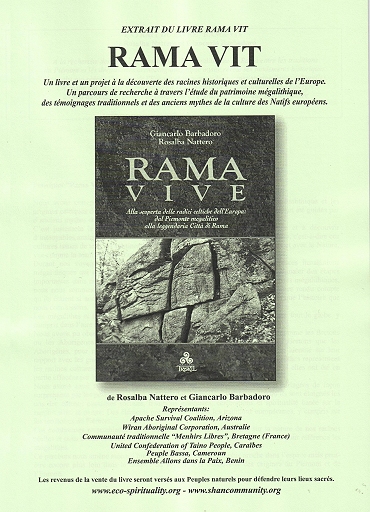
de Rosalba Nattero et Giancarlo
Barbadoro A la recherche des traces de l'ancienne ville mégalithique de Rama entre
les traditions du Piémont et les découvertes archéologiques où le mythe révèle ses
fondements historiques. Un mythe qui raconte la descente d'un Dieu porteur de la connaissance qui
s'intègre à celui du Graal et permet de comprendre l'événement archaïque
extraordinaire qui a peut-être changé le destin de l'humanité. 1 - Les CELTes Et Le Mythe Du GRAAL Pourquoi
“Rama Vit”?
Nous
avons entrepris cette recherche poussés par l’intérêt pour la culture
mégalithique et les origines celtiques de l’Europe, et dans ce travail qui est
le notre nous avons souvent été guidés par d’anciens mythes et surtout par
celui du Graal. C’est
justement le Graal qui nous a amenés à voyager à travers le monde et à
découvrir d’incroyables analogies entre les cultures que nous définissons
« Peuples naturels », c'est-à-dire ces cultures issues de tous les
continents qui conservent et défendent leur rapport direct avec la Nature, vue
comme la manifestation d’un mystère, essence même de l’existence. Durant nos voyages, nous nous sommes souvent trouvés
face à d’imposantes installations mégalithiques qui semblaient représenter une
constante dans nos parcours et signaler des étapes importantes dans notre
recherche. Face à la présence étendue de nombreux restes mégalithiques, nous
nous sommes demandé ce qu’ils pouvaient représenter. Nous nous sommes rendu
compte qu’ils étaient si anciens qu’ils représentaient un passé lointain, bien
plus vieux que l’histoire que nous connaissons. Les mégalithes et les caractéristiques culturelles
liées à ceux-ci sont présent sur tout le globe, y compris dans l’aire de
l’Europe et en particulier au Piémont. Nous avons pu observer que le lien culturel entre
les mégalithes et les peuples comme les Bretons ou les Aborigènes australiens
est encore vivant et continu. Aussi bien les Bretons que les Aborigènes, pour
n’en citer que quelques uns, fondent leurs traditions et leur identité sur leur
rapport avec les grandes installations. Cela nous a amené à penser que les
mégalithes représentent les racines culturelles à partir desquelles provient
l’humanité moderne (même si elles ont été en partie effacées par les religions
qui sont arrivées ensuite). Nous avons aussi été frappés par les
caractéristiques culturelles spécifiques partagées de façon surprenante par les
peuples ayant un lien avec les mégalithes, y compris lorsqu’ils sont éloignés
les uns des autres : coutumes sociales, traditions musicales, célébrations
et spiritualité basée sur le rapport avec la nature. Des éléments présents
aussi dans les traditions européennes, y compris sur les territoires du
Piémont. Ces nombreuses ressemblances nous ont amenés à
nous questionner sur la nature de nos racines réelles et nous avons commencé
une récolte des légendes et des traditions ayant pour référence les mégalithes. Ce parcours nous amène aujourd’hui à entreprendre
un voyage plus proche dans l’espace mais peut-être encore plus loin dans le
temps : un voyage à la découverte des origines du Piémont et de l’Europe. Dans ce parcours, parfois brumeux, parfois
limpide, nous sommes guidés par d’anciens mythes et surtout par une très
vieille légende : la légende de la ville de Rama, liée elle-aussi au mythe
du Graal. A travers la récolte du corpus de légendes
transmises dans les vallées piémontaises, il émerge un puzzle permettant de
délimiter un cadre complexe qui peut avoir des revers historiques justement à
travers l’interprétation des restes
mégalithiques existants. Notre recherche s’adresse à une ère
protohistorique et archaïque. Nous essayons de recomposer la mosaïque d’une
histoire apparemment détruite par plusieurs siècles de manque d’information, de
désintérêt et de réécriture des histoires. Peut-être que nos origines
proviennent justement de ce peuple mystérieux qui a disparu dans le vide mais
qui a laissé de profonds indices de sa présence : les restes
mégalithiques. Les Celtes aimaient la nature, les bois étaient
leurs temples, leur écriture s’inspirait des arbres. Pour notre recherche, nous sommes justement partis
de cet amour pour la nature, pour la Terre et ses habitants, pour notre terre. Et nous avons fait des découvertes qui nous ont
étonnés et enthousiasmés… Nous ne désirons pas arriver à une conclusion
précise, nous voulons seulement partager nos recherches avec d’autres
passionnés, comme nous, et montrer le grand patrimoine que nous avons à portée
de main et qui peut être sous les yeux de tous. Divulguer la réalité historique
du mégalithisme et des mythes qui y sont liés afin que chacun puisse en tirer
ses propres conclusions. Nous laissons aux experts du secteur le travail de
catalogage et le soin d’évaluer les restes instrumentalement parlant . Nous
espérons que les experts s’intéresseront à nos recherches et entreprendront une
enquête approfondie sur les restes mégalithiques et sur tout ce qu’ont laissé
les peuples qui nous ont précédés, ce qui représente la culture de laquelle
nous provenons. Les
Celtes et l’Europe
Nous sommes habitués à considérer nos racines et
notre histoire en fonction des informations que nous fournit la culture dans
laquelle nous sommes nés et nous avons grandis. En général on ne tient pas
compte des racines anciennes sur lesquelles se base notre culture elle-même et
qui en sont à l’origine. Mais le patrimoine de l’humanité n’est pas
constitué exclusivement par les monuments architecturaux du passé : il
existe un grand patrimoine transmis par la mémoire historique de l’humanité,
constitué par les mythes et les légendes de tous les peuples de la terre, qui
accompagne obstinément l’histoire de l’homme, prêt à être interprété et
recomposé comme un énorme puzzle, gardien jaloux de mythes millénaires et
d’enseignements ancestraux. Il est assez courant de penser que sur le
continent européen, avant l’apparition de l’Empire Romain, aucune autre grande
civilisation n’ait existé. Un lieu commun amplement justifié vu que les livres
d’histoire eux-mêmes nous proposent une Europe ancienne aux contours
historiques indéfinis, habitée par des peuples anonymes, sauvages et
prédateurs. Selon les traditions anciennes, survécues à
travers les millénaires, on parle au contraire de l’existence d’une
civilisation importante qui serait même apparue tout à fait au nord 6 000 ans
av. J.C, puis qui se serait étendue vers le centre de l’Europe. Une
civilisation née suite aux migrations progressives des populations provenant de
l’aire de la Mer Noire après que les glaciers de la dernière glaciation,
environ 12 000 ans av. J.C, se soient retirés, libérant ainsi les terre du nord
de l’Europe. C’est à cette époque que naquirent les grands
monuments mégalithiques, qui par leur indéniable présence sont aujourd’hui
encore les témoins d’une ancienne culture qui les éleva dans la nuit des temps
de l’histoire européenne. Les monuments mégalithiques, que nous pouvons
aujourd’hui encore observer dans le monde entier, sont évidents et ils sont les
témoins de la connaissance de la construction de ces cultures. Cela dit nous
ignorons l’existence des œuvres raffinées d’orfèvrerie, aujourd’hui enfermées
dans des musées, des objets que seul un peuple doté d’une grande sensibilité,
de gout et surtout d’une certaine capacité technologique pouvait avoir créés. Nous ignorons l’existence des mythes et des
épopées qui n’ont rien à envier aux récits bibliques et aux œuvres de la Grèce
antique. Nous ignorons les connaissances mathématiques et astronomiques grâce
auxquelles les anciens Natifs européens ont construits les temples
mégalithiques ainsi que cette métrique musicale particulière que nous utilisons
encore aujourd’hui avec des résultats surprenants sur le plan de l’intérieur. Cette même image des Natifs européens est
aujourd’hui filtrée par ce que les écrivains romains et grecs ont laissé dans
leurs narrations domestiques. Dans tous les cas, ils nous parlent d’une culture
qui a perdu ses caractéristiques d’origine, éliminées par de violentes répressions ;
une culture qui n’a survécut que par le mimétisme social, tout d’abord dans le
contexte de l’Empire Romain puis dans celui de l’expansion du Christianisme. Des cultures qui existent aujourd’hui encore, avec
une histoire personnelle, qui s’est développée parallèlement à celles des
cultures dominantes ; des cultures qui ont survécu aux persécutions de
leurs conquérants et qui font aujourd’hui partie de l’identité historique et de
l’expérience des Peuples naturels de la planète. Ce patrimoine est lié à la culture des Celtes,
étendue dans toute l’Europe, une culture dans laquelle ont puisé nos racines. Le mythe du
Graal et la figure de Phaéton L’histoire ancienne du continent européen a été
caractérisée par la présence de la culture celtique qui, au cours de nombreux
millénaires, a amené jusqu’à nous le souvenir d’une grande civilisation,
d’ancien gestes, de mythes et de coutumes populaires et religieuses vivantes et
diffuses, aujourd’hui encore, dans toutes les nations de l’Europe actuelle. Les Celtes étaient un peuple mystérieux qui
affirmait être issu du ciel. Conséquence de leur origine céleste, le nom
Kealteach, ce qui signifiait justement « fils du ciel ». En gaélique,
« Kealteach » signifiait aussi « peuple secret » ou
« homme céleste » quand il faisait référence aux individus un par un.
Les Celtes célébraient leur identité mystérieuse à
travers les anciens mythes qui étaient à l’origine de leur culture : les
mythes des origines représentaient pour les Celtes la base profonde de leur
identité et la source de leur connaissance. La connaissance des mythes des origines permet de
se rapprocher de l’identité la plus réelle et mystérieuse du celtisme, avant
les contaminations culturelles de la part e l’Empire Romain et par la suite du
Christianisme. Par rapport au sens du mythe, dans son Timée
Platon (philosophe athénien – 427-347 av. J.C.) affirme que les mythes ne sont
pas simplement des récits mais une façon de transmettre des événements
historiques à travers le temps afin de leur permettre de passer outre le retour
à la barbarie des civilisations de la Terre à cause des catastrophes
environnementales qui les anéantissent. A cette occasion, Platon établit une relation
entre le mythe de Phaéton et un objet céleste qui serait tombé sur la terre. Le Graal est certainement l’un des mythes les plus
importants des origines du celtisme antique. Il était considéré comme l’origine et la source
pérenne de la connaissance des druides. Par la suite, le mythe du Graal fut
considéré comme l’origine de l’Alchimie. La référence à la connaissance dont le Graal
serait le dépositaire semble être établie par ce même acronyme qui est à
l’origine de son nom : “Gnosis Recepita Ab Antiqua
Luce”. Le mythe du Graal est présent dans de nombreuses cultures de la planète et il a eu de nombreuses interprétations, selon les traditions et les époques historiques. Nous pouvons résumer le récit du mythe du Graal en faisant un syncrétisme composé de plusieurs références traditionnelles : Une créature semi-divine, que certains identifiaient comme un ange, tomba
du ciel au commencement de l’histoire de l’humanité. De l’émeraude tombé de son
front, les gardiens de l’Eden originel firent une coupe de connaissance remise
à Adam et Eve. Quand le couple fut chassé du paradis terrestre, la coupe passa de main en
main depuis l’Eden jusqu’en Egypte où elle fut gardée par Osiris. Après la mort
de ce dernier causée par Seth, la coupe du Graal fut perdue. Des siècles plus tard, se sera le rôle de Merlin, du roi Arthur et des
Chevaliers de la Table Ronde de tenter de la récupérer et de la ramener à
Camelot pour recréer l’Eden perdu. Le mythe du Graal se retrouve dans une autre
tradition du celtisme, liée au mythe que les grecs ont nommé Phaéton et à la
ville mégalithique de Rama, ayant existée dans le passé dans la Vallée de Susa
et dont les origines remontent justement à ce mythe. Voici le récit du mythe grec de Phaéton raconté par Ovide (Publius
Ovidius Naso de Sulmona – 43 av. J.C. – 17 apr. J.C., dans son livre Les
Métamorphoses) : Le dieu fils du Soleil monta en cachette sur le char
solaire du père et se mit à gambader dans le ciel. Toutefois, vu qu’il n’était pas capable de conduire le
char, il tomba sur terre en provocant un grand incendie. D’après le mythe, sa chute aurait eu lieu au croisement
des deux fleuves qui furent par la suite identifiés comme étant le Pô et la
Dora. D’après d’autres légendes, il serait tombé dans le fleuve
Eridan, ancien nom du Pô, qui est aussi le nom d’une grande constellation du
ciel boréal. Il y a une ressemblance narrative évidente entre
le mythe du Graal et celui de Phaéton : une créature de nature divine
tombe du ciel sur la Terre et se manifeste aussi, comme on peut le remarquer
par la suite, comme une entité porteuse de connaissance. Pour cette raison, le mythe de Phaéton semble
tellement se mêler avec celui du Graal qu’ils pourraient démontrer à travers
deux récits différents, la représentation symbolique d’un même événement. Selon cette perspective, l’étude du mythe de
Phaéton, à travers les légendes et les comptes-rendus historiques qui en
parlent, peut permettre de situer le mythe du Graal dans un contexte historique
et de donner un profil compréhensible de la valeur qu’il possède. Un contexte historique qui nous a amené à faire
des découvertes de nature archéologique. Le Stone Circle de Dreamland, Piémont - La reconstitution d'un "cromlech" érigé selon le mythe du
cercle de Phaéton, pour rendre visible la culture celtique dans son rapport
avec la Nature. Un ouvrage d'archéo-astronomie pour permettre au public de
découvrir les phénomènes de la voûte céleste. Un
théâtre d'inspiration ancienne, plongé dans la nature, où se tiennent des
manifestations musicales et culturelles qui évoquent l'esprit de la nature et
de la grande aventure de la vie. 2 - LE MYTHE
DE PHAETON ET DE LA VILLE DE RAMA Phaéton, le dieu civilisateur de la tradition druidique Pendant des millénaires, l’aire du Piémont a été
le théâtre de l’ancienne culture des Celtes qui ont laissé des traces
d’habitations et des traditions relatives aux mythes du Graal et de Phaéton. Les légendes du Piémont interprètent la venue du
dieu Phaéton de façon plus spécifique et avec beaucoup plus de détails que ce
qui est cité dans les Métamorphoses d’Ovide. Des récits qui sont aussi appuyés par des légendes
recueillies dans d’autres parties du continent européen. Celles-ci, bien
qu’étant issues de cultures différentes, démontrent une cohérence
extraordinaire de situations permettant d’enrichir de détails le récit-guide de
la tradition piémontaise et d’obtenir un cadre global précis de cet événement
mythique. D’après les légendes des anciennes traditions
druidiques du Piémont, Phaéton ne serait pas tombé sur terre comme le raconte
le mythe grec, mais il serait descendu du ciel sur son char céleste entièrement
construit en or massif. En outre, il n’aurait pas allumé un terrible incendie
comme dans le mythe d’Ovide, à moins que cet événement ne fût une référence
symbolique au culte du feu ou à la diffusion d’une nouvelle philosophie venue
du ciel qui aurait impliqué tout le continent européen. Le dieu serait descendu avec son char de métal
doré dans la Vallée de Susa, sur les flancs du mont Roc Moal, l’actuel
Rochemelon (Rocciamelone), où existait une caverne sacrée ancienne et mythique
qui s’ouvrait sur le flanc de la montagne pour s’étendre dans les méandres de
sa roche. C’est ici que Phaéton aurait rencontré les hommes
qui vivaient là, dans un passé lointain. Des hommes qui, selon la tradition
druidique, étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui, bien plus grands, si
bien qu’ils étaient décrits comme des géants aux traits monstrueux. Décrits parfois comme de petits sauriens et
serpents anthropomorphes recouverts de plumes multicolores et ayant le sang
chaud. En fonction des légendes, le dieu descendu dans la
Vallée de Susa aurait rencontré après son arrivée une confraternité d’hommes de
cette époque qui pratiquait le culte du feu, considéré comme une émanation du
Soleil, la manifestation de la divinité qui régnait sur l’univers. Phaéton avait choisit une clairière dans une forêt
de la vallée et pour la délimiter il avait fait construire, par ses deux
assistants faits de métal doré, un grand cercle de douze énormes pierres
dressées vers le ciel. C’est ici qu’il accueillait les membres de la
compagnie du feu pour leur enseigner les secrets du ciel et de la terre, les
transformant grâce à sa connaissance en créatures semi-divines. Son enseignement touchait les différentes
sciences, de l’agriculture aux mathématiques, à l’écriture, à la médecine, à
l’astronomie jusqu’à la technologie de la fusion des métaux. A partir de cet événement mémorable, la
confraternité initiale du feu qui faisait des travaux de métallurgie se
transforma en une Ecole initiatique. L’Ecole du Feu commença son œuvre en formant les
premiers druides, les Ard-Ri, qui auraient par la suite civilisé tout le
continent européen. La mission de cette école druidique aura été de
donner vie à la civilisation du bassin fertile de la Mer Noire, la
« civilisation d’Ys ». D’après la tradition des druides, Phaéton aurait
amené en cadeau aux hommes un arbre aux pouvoirs particuliers, l’Yggdrasil,
l’arbre de la vie qui s’étend entre les mondes, capable de conférer bien-être
et connaissance à celui qui le plante ou qui le cultive (symbolisme faisant
référence à la méditation). Dans les légendes du druidisme piémontais, Phaéton
est aussi perçu comme le dispensateur de l’art de l’Alchimie de l’intérieur.
Confirmation de cela, certaines traditions bretonnes antiques déclarent que
Phaéton a été le premier initiateur de l’Alchimie et que l’origine de celle-ci
ne provient pas de l’Egypte mais qu’elle est issue des natifs du continent
européen. Phaéton aurait aussi enseigné l’écriture et les 22
lettres de l’alphabet sacré utilisé par les druides et connu comme étant celui
des Runes et de l’alphabet Oghamique lui seraient attribuées. Un fait qui nous amène à relier le personnage de
Phaéton et celui du dieu égyptien Thot, dieu des sciences et créateur de
l’écriture. Vu les légendes qui existent sur les rapports
entre l’Egypte antique et la région piémontaise, dans laquelle nous citons les
visites d’importants représentants des cours pharaoniques venus en pèlerinage
sur ces terres, nous pourrions aussi prendre en considération l’hypothèse que
le personnage de Phaéton ait été source d’inspiration pour la conception de la
divinité égyptienne. En effet, le personnage de Thot était considéré
comme l’initiateur de la science de l’Alchimie et il a été lié au symbolisme de
la Table d’émeraude – qui rappelle le personnage Lucifer/Phaéton – retrouvée en
possession de Hermès Trismégiste et reconnue comme étant à la base de
l’Alchimie, avec le personnage d’Odin, le chaman nordique créateur de
l’humanité et de la science du « Seidr », l’art thérapeutique du
chamanisme druidique. L’Ecole Alchimique L’Ecole Alchimique, en prenant pour référence le
caractère opérationnel de la fusion des métaux, développa la doctrine
alchimique de la transformation de la matière qui symbolisait, pour les Ard-Ri
(les Initiés), la transformation de la condition subjective du visible en
qualité réelle et invisible de la nature immatérielle de l’existence. L’Ecole était dédiée à l’étude de la Nature et à
l’Ascèse de l’individu. Elle s’occupait de la connaissance du Shan,
c'est-à-dire du mysticisme de la nature immatérielle de l’existence. L’école Alchimique devint l’archétype de l’Art
druidique et au fil des millénaires suivants, elle devint l’Art secret de
l’Alchimie. L’Ecole faisait référence à la figure symbolique
du Dragon (symbole de l’origine même de l’école) qui interprétait la maîtrise
du feu et de l’élévation spirituelle ainsi que les forces cosmiques de
l’univers provenant du Vide. La connaissance et la figure de l’Initié, qui
était capable d’utiliser les forces cosmiques pour son évolution et pour ses facultés
créatives, était issue de cette Tradition archaïque. L’Initié était le Dragon, clerc-guerrier capable
de lutter mais aussi de danser poétiquement dans le vent. L’Ecole Alchimique manifestait son enseignement à
travers des symboles, les plus importants étant le Soleil, le Siv’nul
(chandelier à trois bras), le Dragon et la Coupe (le Graal). L’école initiatique était réservée à la
préparation de l’ordre druidique et elle devint la référence spirituelle
principale pour les cultures du continent européen et de la civilisation d’Ys
après la disparition des civilisations antiques. Par la suite, de cette école provinrent aussi
différentes formes d’applications technologiques ainsi qu’une organisation
industrielle basée sur l’art métallurgique. Phaéton et
les autres mythes des dieux civilisateurs La légende de Phaéton, vu comme dieu civilisateur,
semble posséder de nombreuses affinités avec un grand nombre d’autres légendes
antiques qui racontent des événements et des symbolismes très similaires : -
La mythologie chinoise parle de Houang-Ti, le fils du ciel, qui serait
descendu sur la Terre en 2500 av. J.C. environ, et qui aurait habité dans le
bassin du fleuve Houang-ho. Ce dieu possédait de nombreux chars qui se
déplaçaient sans être tirés. Après avoir vécu sur notre Terre pendant trois
siècles, Houang-Ti retourna sur l’étoile de laquelle il était venu et qui se
trouvait dans la constellation du Lion. -
L’historien assyrien-babylonien Bérose rappelle le mythe du dieu Oannès qui
émergeait chaque jour du Golf Persique pour enseigner les sciences aux hommes
des temps anciens. -
Une légende des Natifs américains du Sud-ouest concerne le dieu barbu du
Meteor Crater qui serait descendu du ciel avec grand fracas pour enseigner la
connaissance aux Hopi. A noter que le cratère en question est de forme
curieusement carrée et que le météore qui aurait du en être à l’origine n’a
jamais été retrouvé. -
Toujours chez les Hopi, il existe le mythe des Katchina, les dieux qui dans
les temps anciens amenèrent la connaissance aux hommes. -
Chez les aborigènes australiens il existe le mythe des Seigneurs de
l’Alcheringa qui dans « le Temps du Rêve » amenèrent aux peuples de
la Terre la connaissance ainsi que les rites sociaux et initiatiques, -
Dans le mythe hébreu, il existe la croyance des Elohim, les dieux qui
créèrent Adam et Eve et donc toute l’humanité. -
Dans les mythes Quiché de l’Amérique Centrale, cités dans le poème
« Popol Vuh », il existe le mythe du dieu colonisateur Vacub Xachix,
« Sette Are », qui descend du ciel pour apporter la connaissance aux
hommes. -
Chez les Mayas il existe le mythe du dieu colonisateur Quetzalcóatl, le
« serpent à plumes », qui est associé à la planète Vénus,
« l’Etoile du matin ». Phaéton et
Njambé, le dieu civilisateur de Ngog Lituba En Afrique, les anciennes traditions du Peuple des
Bassas du Cameroun affirment qu’au début des temps, se manifesta le dieu vivant
Nyambé, l’ancêtre des anciens. Il créa les esprits, le premier couple humain à
qui il donna sa connaissance divine, ainsi que l’immense forêt là où il était
apparu et où il avait placé l’immense rocher de Ngog Lituba dont le nom
signifie « rocher percé » et qui indique l’existence d’une grotte
sacrée. Nyambé avait planté le « Singue », un
petit arbre qui consentait de retrouver la santé et une nouvelle jeunesse ce
qui permettait de recommencer une nouvelle vie. Le peuple africain naquit à partir du premier
couple d’êtres vivants et quand il devint nombreux, il commença à se répandre
sur tout le continent. Nyambé réunit alors son peuple sur le mont du rocher
percé et il se congédia en ordonnant à ses élèves, reconnus comme étant
Mbombock ou Mpeh Mpeh selon les tribus, de continuer son enseignement au sein
des différentes nations qui étaient en train de se former. Le rocher sacré de Ngog Lituba en Cameroun
Le mythe de Ngog Lituba semble se superposer
inévitablement à celui de Phaéton. D’après ce mythe aussi, l’ancien dieu vivant
parmi les hommes est mis en relation avec une montagne, le Roc –Maol (nom
celtique du mont actuellement nommé Rochemelon (Rocciamelone), dans la région
Piémont), elle aussi « percée » en son flanc à cause de l’ouverture
d’une grotte ancienne et mythique. Phaéton, tout comme Njambé, amène lui aussi en
offrande son savoir divin et l’arbre de l’Yggdrasil qui pouvait apporter bien-être
et connaissance. Avant de quitter les hommes, il leur donna une
grande roue percée faite d’or et d’après le mythe, grâce à différentes écoles
initiatiques, ses élèves, les Ard-Ri, portèrent son enseignement à travers tout
le continent européen, depuis l’extrême nord jusqu’au bassin fertile de
l’actuelle Mer Noire. Phaéton et
la Saga des dieux d’Asgard La mythologie du Grand Nord européen célèbre la
saga d’Odin et des dieux de Sagard, un élément central des cultures viking et
celte qui situe dans un contexte historique le mythe des origines et plus
spécialement les événements primordiaux de l’humanité et qui développe donc sur
un plan historique et légendaire le mythe du Graal et de ses implications
culturelles. On y met en évidence le personnage de Loki qui, vu
les propriétés du symbole anthropomorphe qu’il revêt, est associé au mythe du
Graal et par conséquent au personnage de Phaéton. Certains chercheurs associent son nom à ce qu’il
représente de gaélique dans le latin « lux, lumière » ou « porteur
de lumière » et il montre une analogie avec « logi », la flamme. C’est pour cette raison que Loki est souvent
comparé au personnage de Lucifer, l’ange rebelle qui, en tombant du ciel,
laisse s’échapper de son front l’émeraude avec lequel sera réalisé la coupe du
Graal, c'est-à-dire de la connaissance. Loki, en tant que porteur de connaissance comme le
Graal et Phaéton, d’après la mythologie nordique, aurait en effet appris à
Odin, roi des dieux de Sagard, le moyen d’obtenir les Runes, source de savoir du
monde divin et du monde physique. Phaéton et
la grande roue percée faite d’or Phaéton est évoqué comme un dieu secret et même
son vrai nom reste un secret connu et transmis seulement par les élèves qui
sont plus proches de lui, les Ard-Ri. Les légendes de nombreuses cultures natives de la
planète font souvent référence à son aspect et son identité à travers le
symbolisme du Dragon, une figure qui interprète aussi bien le côté divin que
les forces du cosmos et celles de son énergie vitale. Après son arrivée, Phaéton fit construire un grand
cercle de pierres dressées vers le ciel par ses deux assistants faits de métal
doré et sortis de son grand char céleste. Un détail repris de façon similaire par d’autres
mythes comme celui du dieu Vulcain de l’Iliade d’Homère, lequel était assisté
par des créatures en or qu’il avait construit lui-même et qui étaient capables
de parler, réciter des poèmes et danser. Ou alors comme le mythe de Houang-Ti,
le fils du ciel de la mythologie chinoise, qui descendit sur la Terre pour
habiter dans le bassin du fleuve Houang-ho et qui avait à sa disposition
quatre-vingts serviteurs faits de métal avec quatre yeux et six bras chacun et
qui se nourrissaient de pierres et de sable. A l’intérieur de ce grand cercle de pierre Phaéton
accueillait ses élèves et leurs enseignait ses sciences secrètes. C’est en ce lieu que naquirent les premiers
druides, les Ard-Ri, qui auraient par la suite emmené sur tout le continent
européen la science apprise du dieu et auraient contribué à créer les bases de
la culture celtique. Quant vint l’heure de prendre congé des hommes, avant de quitter la Terre, Phaéton
réalisa une grande roue percée faite d’or, de deux mètres de diamètre,
déclarant que celle-ci contenait toute la science qu’il avait enseigné et
qu’elle aurait servi à la transmettre aux futures générations, en plus d’être
un souvenir de son passage. L’événement narré par la tradition rappelle le
mythe du dieu africain Nyambé et du grand rocher percé. Nyambé arriva lui aussi
sur la Terre pour enseigner les sciences aux hommes et il créa lui aussi une
lignée d’initiateurs qui auraient parcouru le continent africain afin de
diffuser sa connaissance. La
naissance de la ville mythique de Rama D’après les anciennes traditions druidiques, dans
les vallées du Piémont, près du cercle de pierres où Phaéton rassemblait ses
élèves, un sanctuaire (le Sanctuaire du Feu) fut réalisé dans une ancienne
grotte, déjà considérée sacrée auparavant et qui se trouve dans le mont
Roc-Maol, l’actuel Rochemelon (Rocciamelone). Autour de ce complexe un premier bourg fut
construit, il accueillit d’abord ses élèves puis plus tard les pèlerins qui
venaient honorer le dieu. Par la suite, après que Phaéton eut pris congé des
hommes, le bourg se transforma en une immense ville mégalithique, celle dont on
se rappela par la suite comme étant la ville de Rama. Rama n’était pas la seule grande construction en
pierre comme se présentait à l’origine le bourg, elle faisait partie d’une
immense agglomération urbaine qui comprenait des centres habités plus petits. Un complexe urbain qui s’étendait de l’actuelle
ville de Susa vers le versant français, jusqu’à la zone de la ville actuelle de
Turin, presque sur les rives du fleuve Po. La ville principale qui s’était développée autour
de l’ancien Sanctuaire du Feu, aurait été construite déjà dès le départ en
utilisant de grands blocs de pierre. Les murs cyclopéens du complexe principal de Rama
se déroulaient sur 27 kilomètres environ et ses immenses arcades en pierre
s’étendaient sur toute la largeur et la longueur de la vallée, le long de la
ligne directrice des petites villes de Bruzolo-Chianocco-Foresto, sur les rives
du fleuve Dora. Les récits des traditions locales relatent que les
constructeurs de Rama vénéraient le soleil et le feu comme des symboles
spirituels. Ils étaient d’habiles métallurgistes et ils forgeaient des objets
en métal. Ils extrayaient un de leurs minerais particuliers
de la zone de Mompantero, des mines du Bois Noir. D’après les études des
chercheurs du siècle précédent, il semblerait que par la suite les romains,
influencés par les légendes sur Rama, cherchèrent leurs puits miniers et les
explorèrent afin de comprendre ce qu’ils en extrayaient. Toujours d’après ces récits, les habitants de Rama
étaient considérés comme étant de grands magiciens et des alchimistes très
doués pour les sciences exactes ainsi que pour les sciences occultes, en outre
ils possédaient des machines qui faisaient des choses merveilleuses. La ville semble avoir développé sa splendeur
architecturale et son influence politique autour de 4000 – 3000 ans av. J. C.,
grâce à l’apport de la culture des Pélasges qui abandonnaient le bassin fertile
de la Mer Noire désormais détruit par un débordement de la Mer Méditerranée. Les Pélasges étaient connus au sens général comme
les Peuples de la Mer, des peuples qui émigraient de leurs terres à la
recherche de nouveaux territoires sur lesquels vivre après que le grand déluge
cité par Deucalion ait détruit leurs terres d’origine. La fin de
la ville cyclopéenne Les récits locaux recueillis par
les chercheurs relatent que la ville de Rama fut détruite par un grand déluge
qui arriva à l’improviste. D’autres encore expliquent que sa
disparition fut causée par une gigantesque avalanche de glace et de pierres qui
la fit disparaitre en l’enfouissant pour toujours sous les débris. D’autres auteurs soutiennent la
version d’un tremblement de terre imprévu et destructeur dans la vallée qui
rasa au sol la ville et que par la suite elle ne fut plus reconstruite. Les légendes permettent de
reconstruire l’événement de la disparition de Rama en la reliant à l’invasion
de la plaine Padane, autour de 600 ans av. J.C., de la part des peuples du sud
qui attaquèrent en force la grande ville cyclopéenne et détruisirent les murs
mégalithiques en faisant fuir les Pélasges vers la mer Tyrrhénienne et au-delà
des Alpes. On peut penser que ces
envahisseurs étaient les Etrusques qui avaient envahi la Padanie autour de 600
ans av. J.C. A remarquer que c’est justement autour de 800 – 500 av. J.C., au
début de l’Age du Fer, que s’est manifesté la culture celtique historique de la
Période de Hallstatt. Il semble que la société des
Celtes transalpins, peut-être issus de la culture des Pélasges de Rama, soit
basée sur le peuple, les guerriers et les druides. C’est à cette époque
qu’apparurent les « torques » et les « chaudrons » rituels. Par la suite, autour de 400 ans
av. J.C., les Gallois-Celtes transalpins transitèrent au sud des Alpes et
chassèrent les Etrusques, reconstruisant partiellement la ville cyclopéenne qui
prit le nom de Rama, en hommage à son constructeur pélasgique et en référence à
la « roche » comme élément de construction de la ville, d’après un
terme gaélique antique. La survie de Rama dans la légende Environ 200 ans av. J.C., les
romains envahirent et dévastèrent la Gaule Cisalpine. Le sanctuaire de Phaéton
fut dissimulé et la grande roue d’or ainsi que d’autres reliques furent cachées
dans de grandes cavernes naturelles que la tradition décrit comme existantes
dans la Vallée Padane et qui rejoignaient le Po en partant du centre de la
vallée de Susa jusqu’au territoire où se dresse aujourd’hui la ville de Turin,
le chef-lieu du Piémont. Les romains saccagèrent ce qu’il
restait de Rama en morcelant et en emportant les grandes pierres des murs qu’il
restait, épargnées par le temps et par les événements telluriques. Dans la Vallée et plus
précisément dans la zone de Mompantero, les légendes locales sont transmises
aujourd’hui encore. Elles relatent de façon très vivante les événements
relatifs à la ville de Rama et à sa disparition. Elles affirment que tous ses
habitants ne disparurent pas mais qu’une partie de ces derniers construisit une
ville dans les viscères rocheux du Roc Maol où ils se réfugièrent tout en
maintenant leur existence secrète. Elles affirment aussi que dans
des endroits secrets, connus seulement par quelques habitants de la vallée, il
y a encore des instruments pour creuser et d’étranges machines qui furent
utilisées par les habitants de Rama et avec lesquelles il est possible de
faire, aujourd’hui encore, des choses extraordinaires. D’autres légendes racontent
encore que le dieu descendu parmi les hommes aurait laissé un de ses assistants
fait de métal doré pour protéger la grande roue en or ainsi que tous les secrets
de sa connaissance. L’assistant du dieu aurait été
capable de se transformer selon son bon plaisir et il se serait transformé en
un grand dragon d’or qui garderait aujourd’hui encore le Graal, sous la forme
d’un émeraude émanant une forte lueur verte, caché dans une grotte dissimulée
dans une montagne de la Vallée de Susa. Phaéton et la civilisation du bassin fertile de la Mer
Noire Le mythe de Phaéton semble ne pas
toucher seulement la région du Piémont, d’après ce que racontent les anciennes
traditions du chamanisme druidique, il étend son influence culturelle sur tout
le continent européen jusqu’au bassin de la Terre fertile de la Mer Noire.
C’est ici, dans la zone où existe maintenant la Mer Noire, que se seraient
fixées pour la première fois les populations qui seront ensuite identifiées
dans la culture des Celtes. Selon les mythes et les
célébrations de ces populations, la zone représentait le berceau antique de
l’humanité, la Terre Impérissable, un foyer archaïque qui avait vu surgir la
splendeur d’une grande civilisation. Toujours d’après les légendes
druidiques du Piémont mais aussi du nord de l’Europe, le mythe de Phaéton et de
la ville de Rama ne touchait pas seulement le territoire piémontais mais
c’était une référence pour tout le druidisme européen, jusqu’à la civilisation
de la Mer Noire, berceau de la culture celtique, d’où provinrent par la suite
les migrations qui caractérisèrent la période proto-romaine et qui, aujourd’hui
encore, lient sur la base de racines culturelles communes les peuples actuels
du Moyen-Orient, de l’Europe, de l’Asie et de l’Inde. Les traditions relatent qu’à
l’époque du début de l’histoire des Celtes, à la place de la mer actuelle, il
existait un grand lac d’eau douce entièrement entouré de terrains agricoles de
terre noire incroyablement fertiles. La civilisation antique de la Mer
Noire était connue comme un véritable Eden qui abritait l’humanité depuis des
milliers voire même des millions d’années. Une humanité formée de différentes
ethnies qui vivaient pacifiquement les unes avec les autres. Une tradition qui reste encore
vivante parmi les populations de culture celtique du Nord de l’Europe comme
étant le mythe de la Terre du Royaume d’Ys, disparue à cause d’une tragédie
antique due à un débordement de la Mer Méditerranée autour de 6000 ans av. J.C.
après la fonte des glaciers de la dernière glaciation (11 000 ans av. J.C.). Aujourd’hui, les explorations
marines réalisées par plusieurs chercheurs ont permis de retrouver sur le fond
de la Mer Noire des restes d’ustensiles et d’habitations. La fin de la civilisation de la
Mer Noire serait à l’origine de quatre grandes migrations des peuples qui
cherchèrent d’autres terres où survivre. Des migrations qui touchèrent le
centre et le nord de l’Europe, les terres baignées par la Mer Méditerranée et
une partie de l’Asie. La fin de la civilisation de la Mer Noire signa aussi la fin d’une ère mythique en donnant vie à un « nouvel ordre » et elle porta à la naissance du monde classique qui représente aujourd’hui les racines de la soi-disant culture majoritaire occidentale. Une reconstitution de l’ancienne ville de Rama -
Le mythe de Rama révèle ses fondements historiques. Un mythe qui réécrit
l'histoire de l'Europe et en marque les racines spirituelles et culturelles. 3 - LE MYTHE DE PHAETON ENTRE CITATIONS ET ARCHEOLOGIE
Ce qui est resté de la ville de Rama et du
mythe de Phaéton
Les nouvelles concernant le mythe
de Phaéton et la ville de Rama semblent
arriver intactes des temps anciens jusqu’au début du XXème siècle puis tout
s’efface et semble disparaitre. Seules les traditions des communautés
traditionnelles celtiques encore présentes et vitales sur le territoire restent
vivantes. Elles maintiennent un profil de
discrétion et dans de nombreux cas de secret par lequel elles comptent protéger
leur présence sur le territoire. La mémoire des persécutions subies après la
promulgation de l’Edit de Constantin influence le maintien de cette position
historique. Par exemple, l’événement emblématique du camp de détention, d’extermination
et de tortures précurseur du camp américain de Guantanamo, ouvert par l’Eglise
chrétienne en 359 apr. J.C. à Skytopolis en Syrie et destiné à accueillir et à
faire mourir les païens qui étaient arrêtés dans tout l’empire, est encore un
souvenir ancré dans les mémoires. C’est quand même grâce à ces
communautés traditionnelles encore présentes, que de nombreuses légendes
survivent dans la tradition piémontaise, continuant à évoquer ainsi le mythe du
Graal et celui de Phaéton. On ne peut certes pas ignorer non
plus la possibilité que les traditions de Rama aient influencé depuis des
siècles et jusqu’à nos jours, la culture laïque des salons des Lumières de la
ville de Turin, chef-lieu Piémontais. Le travail des chercheurs du XIXème siècle et l’œuvre de
Matilde dell’Oro Hermil Le mythe de la ville de Rama a
survécu à travers les siècles, grâce aux traditions orales du druidisme local
mais aussi grâce aux chercheurs du XIXème siècle qui ont recueilli des données
très importantes ainsi que des documents justifiant son existence avant que
ceux-ci ne soient oubliés tout comme les pierres des murs détruites et
confisquées par les romains. Par exemple, nous pouvons citer
le « Dizionario Geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di
S.M. il Re di Sardegna » (« Dictionnaire
géographique-historique-statistique-commerciale des états de Sa Majesté le Roi
de Sardaigne ») datant de 1837 qui à la voix Caprie (Chiavrie) cite
l’existence de la ville de Rama comme vestige d’une civilisation antique ayant
existé dans la vallée de Susa. Nous pouvons citer l’œuvre
encyclopédique de William Smith, « The dictionnary of Greek and Roman
Geography » (« Le dictionnaire de la Géographie Grecque et
Romaine ») publié en 1854. Ce dernier relate le mythe de la ville de Rama. Nous pouvons rappeler Matilde
Dell’Oro Hermil qui a écrit « Storia di Mompantero e del Roc Maol »
(« Histoire de Mompantero et du Rochemelon ») en 1897 dans lequel
elle cite et décrit la ville de Rama d’après les légendes qu’elle avait
elle-même recueillies dans la vallée. Rama dans les citations des historiens romains Le mythe de la ville de Rama
n’appartient pas seulement au corpus des légendes recueillies et rapportées au
début de notre siècle. En effet, dans l’antiquité Rama était déjà connue dans
le monde grec et romain. Au IVème siècle, on localisa
l’existence d’une Rama citée par la culture Gallo-celtique dans la zone
transalpine aux limites de la frontière avec les Alpes cottiennes. Des
témoignages archéologiques confirment la présence antique d’une nécropole
Gallo-romaine par la découverte d’urnes, de torques, de bracelets et de
fibules. Aujourd’hui encore, les récits
locaux de la zone transalpine du côté français parlent d’une ville de pierre
antique qui s’appelait Rama. L’épicentre de la mémoire de la ville de Rama est
situé dans une zone entre Briançon et Embrun, près de la région de la Vallée de
Susa. On pense aussi que dans la zone
de Briançon, tout comme dans celle de la Vallée de Susa, les Romains
utilisèrent les structures de la ville cyclopéenne de Rama, et il en fut de
même dans la Latium où ils intégrèrent dans leur architectures militaires les
anciennes œuvres des Pélasges. D’après les chercheurs de la zone
transalpine, la ville de Rama semble avoir disparue presque entièrement, probablement
à cause d’une catastrophe naturelle. De la ville disparue de Rama, il reste
aujourd’hui encore des traces dans un ravin nommé « Roche de Rama ». Le mythe de Phaéton et la présence du mégalithisme au
Piémont Le mythe de Phaéton ne semble pas
être uniquement un mythe en soi, en effet il est lié à une forte présence de la
culture du mégalithisme qui se manifeste comme un substrat culturel ressenti
dans toute l’aire géographique du Piémont. Dans toute la région piémontaise,
on peut trouver une grande quantité d’œuvres mégalithiques en tout genre. Leur
densité, surtout dans la Vallée de Susa nous amène à évaluer la possibilité que
la zone piémontaise fût une région particulièrement importante pour la culture
mégalithique. Sur le territoire on peut observer des cromlechs, des menhirs
isolés ou placés sur de grandes allées, des dolmens de différentes dimensions,
des cupules et des massifs de cupules, des tumulus, des fontaines sacrées et
des cavernes rituelles. Le phénomène du mégalithisme est
étendu dans toute la région Piémont : 1)
Le mégalithisme de la Vallée de Susa, épicentre des mythes et des récits
historiques du Piémont antique. Un exemple : le complexe sacré de Pian Focero (le
plateau des feux) dans la Vallée de Susa, où une petite colline qui domine les
lieux rappelle énormément la face d’une pyramide Maya. On peut rejoindre le
Plateau par une échelle sculptée dans la pierre et qui monte jusqu’au sommet de
la pyramide présumée et où l’on a découvert trois « masques » de
fabrication toltèque. Sur les lieux, on a retrouvé aussi de nombreux graffitis
représentant le soleil flamboyant. 2)
Le mégalithisme des Vallées de Lanzo 3)
Le mégalithisme de la région d’Ivrea (Canavese) 4)
Le mégalithisme de la région de Cuneo (Cuneese) 5)
La renaissance de la culture du mégalithisme et la reconstruction
archéoastronomique du grand cromlech de Dreamland dans le Parc régional de la
Mandria. La culture du mégalithisme du Piémont se révèle particulièrement riche en
mythes et en connaissances fascinantes, à la portée historique considérable. Un événement qui ne reste pas localisé seulement dans la région mais qui
s’étend sur tout le continent européen, et qui nous touche grâce à ses
événements particuliers. Un des mythes qui caractérisent cette zone culturelle est celui de Phaéton
qui répète, en les situant dans un contexte historique, l’épopée et les
caractéristiques du mythe du Graal. Le mythe de Phaéton et les restes
des roues percées Parmi les restes archéologiques de la culture mégalithique, nous pouvons
surtout citer la grande quantité de roues percées qui ont été retrouvées
dans la région piémontaise. Des restes qui vu leur nombre et leur présence sur le territoire semblent
faire référence au mythe de la grande roue d’or qui aurait été forgée par
Phaéton afin de laisser sa connaissance comme don pour les hommes. Quelques restes de roues percées : -
Les roues de Borgone di Susa, dans la Vallée de Susa -
Les roues de Vaie (sur les parois d’une roche placée verticalement), dans
la Vallée de Susa -
La roue avec cupule de Villarfocchiardo, dans la Vallée de Susa -
La roue de Mompatero (sur les parois d’une roche placée verticalement),
dans la Vallée de Susa -
Les roues aux pieds de la Rocca de Cavour près de Cuneo -
La roue de Balme, dans les Vallées de Lanzo Ces pierres ont parfois été identifiées
comme des « meules », mais cette utilisation semble improbable vu
qu’elles sont sculptées dans des positions parfois non adaptée à cette tache,
comme par exemple sur la verticale de la paroi de pierre de Vaie. Ou comme à
Borgone di Susa où quelques marches creusées dans la pierre permettent même
d’accéder aux « meules » : pour accéder à la zone de travail il
n’y en aurait pas eu besoin et il est impensable que quelqu’un occupé à faire
cette sculpture imposante ait pensé à faire des marches supplémentaires. On peut citer l’exemple de la
soi-disant « meule » de Villarfocchiardo qui porte trois cupules
gravées sur sa surface. Comme nous le savons, la présence des cupules indiquait
le caractère sacré des pierres et des lieux. Le symbole de la roue percée - Auprès des
Peuples naturels de la planète il existe un symbole commun considéré sacré, qui
a le même sens mystique. Un témoignage de l'ancienne culture qui unissait à
l'origine tous les peuples de la terre et qui a donné naissance au mégalithisme. De
Phaéton au mythe de Ngog Lituba, ou d’Odin, de la
conquête de la connaissance secrète de la roue des Runes, au mythe du
Graal e de la Table Ronde, percée elle
même au centre. Un événement
extraordinaire s'est passé aux débuts de l'humanité et a changé l'histoire de
la planète. On peut citer aussi le cas de
Mompantero qui possède une roue solaire placée sur une roche et fêtée chaque
année, à l’occasion de la fête celtique d’Imbolc le 1er février, par
un rite d’origine antique appelé « la danse de l’ours ». Il faut rappeler que le symbole
de la roue percée est aujourd’hui encore connu par de nombreux peuples liés à
la culture du mégalithisme, d’Europe jusqu’en Australie, et de l’Afrique
jusqu’aux populations des Andes. Bien que les roues percées soient présentes en
grande quantité sur toute la planète, nous ne connaissons aucune recherche
archéologique sur leur sens : certains archéologues les nomment boucles
pour ceintures. Les cultures autochtones
attribuent à ce symbole des valeurs spécifiques de la connaissance mystique. Il
possède de nombreux noms : -
La « shahqt-mar » chez les anciens druides européens -
La « medicine wheel » ou « ciangleska wakan » chez les
peuples autochtones d’Amérique du nord -
Le « pi » chez les peuples autochtones de la Chine antique D’autres exemples de la diffusion
de ce symbole : -
Les roues percées des aborigènes australiens -
Les roues percées des îles du Pacifique qui sont semblables à celles de la
Vallée de Susa du point de vue des dimensions : les plus grandes, d’un
diamètre de 1 à 2 mètres, étaient aussi utilisées comme monnaie. Une énigme : le sarcophage du géant retrouvé dans la
Vallée de Susa Une curiosité qui pourrait se
lier à la présence de Rama dans la Vallée de Susa est révélée par le témoignage
de l’archéologue turinois Mario Salomone. Dans les années 70, l’archéologue
témoigna qu’un paysan avait retrouvé, dans un champ de la Vallée de Susa, un
sarcophage de pierre d’une longueur de trois mètres contenant un squelette
proportionné. D’après son témoignage, le tout fut caché et peut-être détruit
par le curé de la zone où il fut trouvé. Les légendes liées au mythe de Phaéton et de Rama Au-delà des restes historiques,
il existe encore de nombreuses légendes populaires qui survivent dans le
folklore de la région Piémont. L’existence de la ville de Rama a
toujours été liée au mythe de Phaéton et de nombreuses légendes relient
l’histoire mythique de Rama au mystère du Graal. Par conséquent, de la même façon
dont survivent aujourd’hui encore les légendes et les restes historiques liés
au mythe de Rama, au Piémont il existe aussi de nombreux témoignages culturels
et historiques faisant référence à la descente de Phaéton et au Graal qui
aurait été conservé pendant de nombreux millénaires par les habitants mystérieux
de cette même ville de Rama. En pénétrant encore plus dans les
légendes des vallées piémontaises, nous pouvons rappeler la survie, pendant des
millénaires et jusqu’à nos jours, de la culture druidique dont le cœur était le
culte solaire et celui du feu. Une culture qui est aujourd’hui
encore célébrée par certaines communautés paysannes du Piémont avec des rites
secrets qui réunissent des centaines de personnes de tous les villages de la
région piémontaise. 1)
Les légendes faisant référence au mythe de Phaéton : -
La légende du grand bloc d’or, reconnaissable comme étant le char de
Phaéton décrit par le mythe transmis par Ovide et transmise dans la Val Grande. -
La légende de la roue tombée du ciel, transmise par une des légendes
relatives au mont Ciabergia, qui peut être liée à la roue d’or forgée par
Phaéton. 2)
Les légendes faisant référence au mythe du Graal La tradition relate que,
après que Phaéton se soit congédié des hommes, ses reliques furent conservées
dans une caverne du mont Roc Maol, l’actuel Rochemelon (Rocciamelone). Il existe à ce propos de
nombreuses légendes médiévales. De nombreux personnages auraient cherché la
relique sans jamais la trouver et leurs exploits sont narrés par les légendes. Les habitants de la Vallée de
Susa racontent que le mythe de la caverne secrète et de ses trésors a continué
y compris au cours de la deuxième guerre mondiale, quand les troupes nazies
occupant les territoires explorèrent les montagnes de la vallée, surtout le
Musinè, à la recherche des cavernes mythiques qui auraient conservé d’anciens
trésors cachés, mais sans toutefois réussir à les trouver. Nous pouvons citer à ce propos
deux légendes médiévales. Citons la légende de la caverne
du Mage dans le Musinè, pleine de symbolismes liés au mythe du Graal. Elle raconte
que dans une grotte à l’intérieur du Mont Musinè qui donne sur la Vallée de
Susa, vivait un mage qui protégeait une grande pierre précieuse verte. Dans la
salle il existait un Dragon en Or placé pour défendre les lieux, ce qui
rappelle une des créatures métamorphes faites de métal doré laissées par
Phaéton afin de protéger la connaissance donnée aux hommes. Il y avait une
fontaine dont l’eau se reversait dans un petit lac dans lequel se
matérialisaient des visions de soldats vêtus d’uniformes bleus et de chapeaux
tricornes qui se battaient, de grands oiseaux qui laissaient tomber des objets
détruisant une ville. Ils virent aussi des chenilles en métal qui se
déplaçaient ensuite parmi les ruines. Nous citons la légende d’Ardouin
III, marquis d’Avigliana, de Susa et de Turin, qui partit en expédition, attiré
par les récits sur les trésors cachés dans la Vallée de Susa dans une grotte du
Mont Rochemelon (Rocciamelone), le Roc Maol des anciens Celtes. Toutefois
Ardouin et ses troupes durent abandonner à cause d’un brouillard épais qui se
levait, impénétrable et accompagné d’une grêle dense de pierres chaque fois
qu’ils s’approchaient des lieux. Nous citons la légende urbaine
selon laquelle le Graal serait gardé à Turin, caché dans un lieu souterrain
indiqué par les symboles de la basilique de la Gran Madre de Turin. Phaéton et la tradition des héritiers de l’art de la
fusion des métaux Un renvoi à la légende de
Phaéton, en relation avec les connaissances métallurgiques enseignées aux
hommes et donc à son enseignement alchimique, provient des traditions des
anciennes compagnies de fondeurs de métaux qui ont continué, dans la Vallée de
Susa, leur activité jusqu’au début de notre millénaire. Nous pouvons rappeler la présence
de cette tradition dans la Vallée de Susa : dans les vallées, il y a
encore quelques décennies, les danses rituelles et sauvages des chaudronniers
étaient encore exécutées autour du feu pendant les solstices et les équinoxes. Les traditions transmises par les
familles des fondeurs de métaux, et surtout celles qui concernaient le secret
du travail de l’or, survécurent aux répressions religieuses. Les communautés du
Mont Romulejo (autre nom du Roc Maol) racontent que leur connaissance du métier
était due à un dieu qui était venu
amener le feu volé au ciel. La survie de Rama dans les toponymes des lieux et dans
les noms des personnes Dans la zone transalpine sur
laquelle se dressait Rama, de nombreuses citations sont encore vivantes
aujourd’hui à travers les toponymes et les noms des personnes qui font
référence à la ville mégalithique mythique. Du côté subalpin de la partie
italienne, dans la Vallée de Susa, il existe différents toponymes rappelant la
présence de la ville de Rama : -
Le « bois de Rama » près de Susa -
Le hameau « Ramat » de la ville de Chianocco -
Les très nombreux noms de famille de personnes faisant référence à Rama -
La
« Via Città di Rama » (« Rue Ville de Rama ») à Caprie Du côté de la zone subalpine
française, nous trouvons d’autres toponymes rappelant le mythe de Rama : -
Le « Château de Rama » près de Champcella dans la vallée de la
Durance -
La petite ville « Roche-de-Rama », près d’Embrun, connue au
Moyen-âge comme « le bourg ou la ville de Rama », qui doit
aujourd’hui son nom à la grande roche qui est considérée comme étant le dernier
bastion de la ville mégalithique du même nom ayant disparu. La roche est
surmontée par une grande croix. -
La rue de Briançon nommée « Rue de Rama, l’ancienne rue des Seigneurs
de Rama ». Le Cromlech de Cavaglià, Piémont La recherche non appliquée sur le mégalithisme du Piémont Le mythe de la ville de Rama et
celui de Phaéton, inévitablement liés par les événements antiques, sont
présents dans de nombreuses légendes existant dans la région piémontaises et
rappelées par l’écho des traditions de tout le continent européen. Il ne manque
pas le soutien de chercheurs de nombreux Pays. Cependant, malgré cette base
culturelle considérable, ces deux mythes ont toujours été relayés à la simple
narration, sans qu’aucune vérification concrète n’ait été réalisée sur la
réalité des événements racontés. Et aucune recherche archéologique tangible n’a
jamais non plus été entreprise afin de faire jour sur ces légendes villageoises
insistantes. Pour la légende de Rama il n’existe
pas non plus de Schliemann moderne, à la poursuite de sa ville de Troie,
pouvant faire jour sur le mystère archéologique millénaire de la vallée de
Susa. Au contraire, d’après ce que l’on
a observé, on pourrait dire qu’une destruction systématique de tous les restes
précieux comme les dolmens, les objets rituels et les représentations
pictographiques a eu lieu dans toute la région piémontaise. Chronologiquement parlant, le
dernier cas est l’endommagement des restes importants que représentaient les spirales
sur la roche de Mompantero, pour lesquelles les autorités n’ont pris aucune
mesure de protection. La découverte des murs de Rama dans la vallée de Susa Toutefois, malgré le climat
d’indifférence qui règne autour du mythe de Rama et de Phaéton, pendant l’été
2007, de grands remparts de murs mégalithique en pierre furent découverts dans
la Vallée de Susa. Et vu le lieu de la découverte, ils peuvent être considérés
comme étant une partie des grands murs de la ville de Rama. Les murs de
Rama - La témoignage important sur la
possibilité de l’existence réelle de l’ancienne ville dans la vallée de Susa en
Piémont. Cette découverte représente un
témoignage important sur la possibilité de l’existence réelle de Rama, au-delà
de ce qui est évoqué par la narration du mythe et des légendes populaires. Les murs semblent sortir de la
montagne, on pourrait déduire qu’ils ont été enfouis par des avalanches
naturelles survenues au fil du temps. Les pierres constituant les murs de Rama
sont carrées (par conséquent elles ont forcement été fabriquées par l’Homme) et
elles ont des dimensions considérables. Les rocs sont dressés les uns sur
les autres, avec des blocs de pierre d’une taille moyenne de 1m80 de haut sur
1m60 de large et autant de profondeur. On peut estimer que chaque pierre des
murs de Rama pèse entre 4 et 5 tonnes. Les pierres paraissent placées
selon des découpes qui semblent avoir pour but de leur apporter une certaine
cohésion et par conséquent une compacité de l’ensemble des murs. Dans certains
cas, on peut remarquer combien les pierres sont encastrées les unes dans les
autres, sans qu’il ne soit possible d’y glisser la lame fine d’un couteau. L’aspect de ces murs, vu leur
forme et leur élaboration, peut rappeler celui des forteresses des Andes ou les
pierres à plusieurs angles de Cuzco. Ils rappellent s’en aucun doute les murs
des forteresses mégalithiques du centre de l’Italie comme ceux de la zone du
Circé du Latium, près de Rome, qui ont été réalisés on suppose, par les
Pélasges puis réutilisés ensuite par les romains. Ils peuvent aussi être assimilés
à certaines œuvres mégalithiques de la Sardaigne. Les fouilles archéologiques de la zone de Briançon Sur le versant français aussi ont
lieu des fouilles dans un site archéologique attribué à la Rama antique. Depuis plusieurs années, dans le
site archéologique de Champcella, près de la commune
« Roche-de-Rame », entre Embrun et Briançon, des fouilles
archéologiques sont en cours. Les dernières, en mai 2007 ont porté au grand
jour des constructions de style mégalithique semblables à celles des murs de
Rama trouvées dans la Vallée de Susa. La découverte de Rama et la leçon que l’on peut tirer de
Platon La découverte des mus de Rama
porte l’existence de la ville mégalithique antique au-delà du mythe et cela
révèle que Rama ne doit plus être considéré comme une légende mais plutôt comme
un fait historique bien concret. Comme disait Platon dans le
Timée, en parlant du mythe comme d’une façon de raconter des événements ayant
réellement eu lieu, peut-être que le mythe de Rama pourrait cacher des notions
historiques devant encore être découvertes. -
Quels autres secrets pourraient encore être découverts ? -
Le personnage de Phaéton a peut-être lui aussi une valeur historique
précise allant au-delà du mythe ? -
Qu’est-ce que le mythe de Phaéton a représenté pour les anciens
Celtes ? -
Que peut-il encore révéler à notre époque ? Il peut au moins représenter les
racines antiques du Piémont et probablement de tout le continent européen,
comme semble le démontrer la continuité actuelle de la tradition et de la
spiritualité du druidisme local dans la région Piémont et peut-être même dans
la zone transalpine du côté français. 5 – LE PROJET « RAMA
VIT » Il
existe un patrimoine constitué de restes mégalithiques, de mythes anciens, d’us
et de légendes qui ne doit pas disparaitre. Il faut
entreprendre une recherche qui utilise surtout les restes mégalithiques afin de
tracer une carte des lieux. Une carte des sites archéologiques qui transmette
l’idée de l’extension des zones historiques intéressées. Il est
tout aussi important de récupérer le grand bagage des traditions orales, des us
et des coutumes qui sont encore transmis aujourd’hui. Lors du
rassemblement de ces connaissances, nous pensons qu’il faut distinguer : -
les mythes de l’origine,
c'est-à-dire le bagage spirituel des mythes faisant référence à la naissance de
l’univers et à la naissance de l’humanité. -
les éléments historiques,
c'est-à-dire les restes, les documents historiques, les références à des sites
mégalithiques et tout ce qui documenté historiquement parlant. -
les traditions de ladite
« religion antique », c'est-à-dire le bagage très étendu de
connaissances, de coutumes, de remèdes et de rites transmis de façon directe. -
le folklore, c'est-à-dire le bagage
de connaissances rapportées et réinterprétées selon la culture et la religion
qui les utilisent. Ce dernier élément est souvent pollué par des
interprétations bouleversant le sens d’origine du mythe, de la légende ou de la
coutume. Par exemple, les interprétations du personnage de la
« masca », autrefois considéré comme la représentation du Chamane et
devenue par la suite la « sorcière », ou encore l’interprétation des
légendes liées aux lieux mégalithiques et auxquels on associe souvent le démon,
voir le cas de l’attribution des cupules. Ce
travail veut représenter le début d’une recherche et aussi la pointe d’un
iceberg révélant peu à peu un monde antique encore tout à découvrir. Nous
croyons qu’il est important de remettre au jour les racines qui sont les nôtres
afin de leur donner un visage précis. Nous
sommes convaincus de l’importance de la connaissance de nos propres racines
pour mieux comprendre le présent et pour affronter le futur qui nous attend. Le
dolmen de Cantoira, Piémont
|